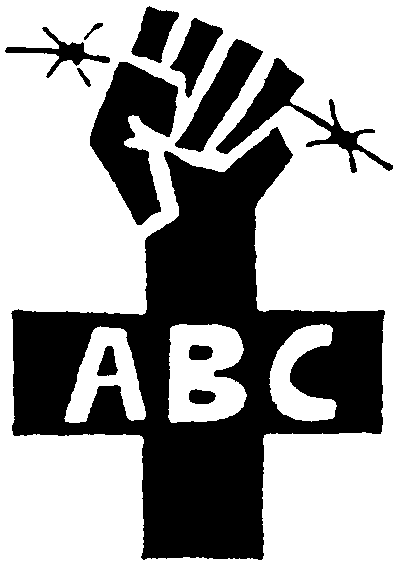En lisant des textes en langue espagnole sur la répression, il assez fréquent de tomber sur le terme de « montage ». Montage policier, judiciaire, politique ou montage tout court, le mot est souvent mis à toutes les sauces, générant pas mal de confusion quant aux réalités qu’il prétend décrire ou résumer. Considérations sémantiques mises à part, il nous semble surtout important de revenir sur les ambigüités que ce mot-tiroir peut, plus ou moins volontairement, engendrer ou entretenir. En effet, à l’heure où la répression vient, une fois de plus, frapper à la porte des anarchistes avec les uniformes des flics et les costumes des juges (comme dernièrement avec l’Opération Pandora par exemple), il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de clarté dans la manière de l’affronter.
En lisant des textes en langue espagnole sur la répression, il assez fréquent de tomber sur le terme de « montage ». Montage policier, judiciaire, politique ou montage tout court, le mot est souvent mis à toutes les sauces, générant pas mal de confusion quant aux réalités qu’il prétend décrire ou résumer. Considérations sémantiques mises à part, il nous semble surtout important de revenir sur les ambigüités que ce mot-tiroir peut, plus ou moins volontairement, engendrer ou entretenir. En effet, à l’heure où la répression vient, une fois de plus, frapper à la porte des anarchistes avec les uniformes des flics et les costumes des juges (comme dernièrement avec l’Opération Pandora par exemple), il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de clarté dans la manière de l’affronter.
Il est évident que nous ne pourrons et ne voudrons jamais nous mettre à la place du pouvoir ni réfléchir comme lui, et que nos critères ne sont pas les siens. Cependant, avoir quelque analyse et quelque réflexion précise sur ses buts et ses méthodes, notamment en matière de répression, peut donner des pistes pour y faire face. Sachant bien sûr que nous déterminerons toujours les chemins à emprunter en cohérence avec nos idées et nos perspectives anti-autoritaires, pour sortir du terrain miné de l’ennemi et agir de manière qui nous semble la plus appropriée.
Au regard des expériences du passé, les opérations répressives de grande envergure de l’État, sous ses différentes formes (monarchie, dictature, démocratie… ) contre ses ennemis déclarés, les anarchistes, n’ont rien de bien nouveau. Elles sont même assez classiques dans des contextes d’effervescence sociale et d’intense activité subversive. Que l’on pense aux lois et aux grands procès anti-anarchistes dans la France de la Belle époque et de la propagande par le fait, aux procès de Montjuich dans la bouillante Barcelone de 1896, à Sacco et Vanzetti et tant d’autres compagnon-nes aux États-Unis dans leur farouche opposition à la Première guerre mondiale et ses suites, à la Valparaiso (Chili) insurgée en 1920, une des stratégies de l’État a consisté à s’emparer d’un ou plusieurs faits spécifiques pour lancer de vastes coups de filet contre une partie ou l’ensemble du mouvement anarchiste, et faire tomber à la pelle des condamnations de toutes sortes (exécutions, lourdes peines de prison, déportations…). Dans ces cas-là, les objectifs affichés étaient clairs : outre la vengeance à tout prix contre des compagnon-nes qui ne faisaient pas mystère de leur volonté d’en finir avec un monde fondé sur l’exploitation et la domination, il s’agissait aussi de mettre un terme à l’offensive révolutionnaire contre l’État et le Capital. Le rôle précis des personnes incriminées dans telles ou telles affaires jouait alors pour la Justice un rôle presque secondaire. C’est avant tout la responsabilité dans une dynamique d’attaque contre les puissants qu’il fallait châtier, et intimider en faisant des exemples.
Aujourd’hui encore, bien que la conflictualité sociale et le contexte de luttes aient changé, la répression contre des anarchistes reste à l’ordre du jour dans nombre de pays, et la signification profonde d’une expression comme « ni innocents ni coupables » continue à se poser avec autant d’acuité. Le fait que les avocats jouent sur la légalité des procédures ou plaident l’absence de preuves dans l’enceinte des tribunaux est une chose, mais c’en est une autre qu’une grande partie d’un mouvement s’attache elle aussi à démontrer l’innocence des compagnons. Cela peut être lié à de réelles divergences de fond –tout le monde ne partageant pas la position d’un Novatore sur le fait que les « coupables » méritent encore plus notre solidarité que les « innocents »- ou simplement à une faiblesse d’analyse de la situation et du fonctionnement de la justice comme arme au service du pouvoir.
Or, face à des répressions spécifiques, des anarchistes ont proposé et eu à cœur de continuer à faire vivre les dynamiques de lutte ou de soutenir l’offensive, plutôt que de clamer haut et fort l’extériorité des compagnon-nes aux faits reprochés, parfois avec l’idée d’établir un rapport de force susceptible de les tirer des griffes des geôliers, parfois par vengeance ou tout simplement mus par un lien de profonde continuité d’idées, de pratiques et de perspectives. A l’inverse, d’autres réactions ont aussi pu consister à minimiser le contexte ou une partie des faits dans l’espoir de recueillir un plus large soutien, ou encore à tenter lourdement d’éloigner le plus possible le danger de soi, notamment en prenant de prudentes distances avec ce que l’État prétendait vouloir frapper.
Un des exemples historiques fréquemment utilisé pour illustrer les montages est celui de la Mano Negra en Espagne, et ce n’est à notre avis pas un hasard. En 1882, les attaques en tout genre qui se multipliaient en Andalousie, essentiellement contre les grands propriétaires terriens, furent attribuées à une organisation secrète : la Mano Negra. Sur ce, des milliers de journaliers agricoles et d’anarchistes de la région (les chiffres varient de 3000 à 5000) furent arrêtés, la plupart membres de la FTRE (fédération syndicale espagnole liée à l’AIT). Finalement, parmi des centaines de personnes enfermées et chassées et au bout de ce qu’on peut imaginer de tortures, 14 d’entre elles furent condamnées à mort pour un assassinat. Nous ne saurons probablement jamais si elles avaient ou non participé à cet assassinat particulier et fait partie de la Mano Negra, mais ce qui est sûr c’est qu’en l’occurrence l’État voulait régler bien autre chose qu’une histoire de meurtre. Ce qui manifestement l’inquiétait, c’était à la fois la multiplication des actions directes et l’émergence d’une organisation formelle de masse du type FTRE qui comptait des dizaines de milliers d’affiliés disposés à lutter contre les conditions de misère qui leur étaient imposées. C’est donc de l’ensemble qu’il voulait se débarrasser, y compris en jouant sur les différences internes au mouvement. Mise au pied du mur et pensant certainement se préserver en tant que structure, la FTRE s’est placée sur le terrain posé par l’État, à la fois en niant l’existence de la Mano Negra (d’où la thèse d’ailleurs fort controversée qu’il s’agirait d’une création des flics) et en condamnant des pratiques d’action clandestines ne correspondant pas à sa stratégie du moment.
Cet exemple nous semble révélateur en ce qu’il illustre une des stratégies répressives de l’État, plus encore quand il ne dispose pas de personnes prises sur le fait : d’un côté désigner les coupables qui lui semblent les plus appropriés, et en même temps profiter de l’occasion pour faire le tri entre les bons anarchistes et les mauvais. Objectif de départ ou effet collatéral –nous le répétons notre intention n’est pas de pénétrer l’esprit tordu des sbires -, toujours est-il que dans ces situations, les prises de distance ont également émaillé l’histoire du mouvement anarchiste. Cela fut notamment le cas lorsque des organisations formelles, parfois de masse, avec l’enjeu de leur possible interdiction ou légalisation, se sont abstenues ou ont pris soin de ne pas reconnaitre tel ou tel compagnon-ne comme anarchiste –comme s’il fallait quelque carte de membre pour l’être et agir en tant que tel–, voire se sont jointes aux chœurs condamnant telle ou telle action.
Nous n’allons pas développer ici tous les problèmes que soulèvent les notions de « représentativité » au sein du mouvement anarchiste, de ce que pourraient être les pratiques « communément admises » par cet ensemble (pourtant aussi indéfinissable que protéiforme) ou la place accordée aux actions minoritaires … Ce qui est par contre certain, c’est que ces problèmes deviennent particulièrement aigus quand, en plus, les réactions par rapport à des initiatives offensives se calquent sur les normes répressives du pouvoir, elles-mêmes implicites et à géométrie variable selon les nécessités et les situations du moment. Lorsque des actions ne sont plus considérées selon des critères individuels et éthiques, lorsque les percevoir comme « minoritaires » les rend d’emblée suspectes, lorsque leur pertinence ne se mesure qu’à l’aune de l’épée de Damoclès qu’elles pourraient faire tomber sur tous, alors c’est que le calendrier politique et répressif a pris le pas sur les idées.
Certes des débats peuvent surgir autour du partage ou pas de certaines actions, de leurs objectifs, de leurs méthodes ou de leur pourquoi mais ils doivent être menés entre compagnon-nes et de manière appropriée, c’est-à-dire loin des oreilles du pouvoir, des projecteurs des médias et des espaces virtuels de communication, et surtout pas sous les injonctions de l’Etat à qui on se sentirait obligé d’apporter des réponses et des garanties quand il nous met en joue.
Pour en revenir à la question du « montage », il semble qu’un réflexe quelque peu conditionné consiste à mettre en avant cette expression assez pratique afin de mettre tout le monde d’accord contre ce qui serait une injustice manifeste. En réalité, ce réflexe amène généralement à ne pas toucher les mécanismes de fond de la justice. Si l’État n’a certes souvent pas hésité à mener la guerre contre ses ennemis déclarés en allant à l’encontre de ses soi-disant propres règles (fabrication de fausses preuves, faux aveux et témoignages obtenus par le chantage ou sous la torture etc.), ce serait cependant une grossière erreur d’oublier que la justice est en soi un instrument forgé à son image et pour son usage.
Depuis belle lurette, le pouvoir s’est doté des moyens de punir non seulement les auteurs matériels de certains faits, mais aussi celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre auraient pu rendre leur réalisation possible. La notion de complicité est d’ailleurs extensible au point d’englober parfois la complicité passive ou morale, consistant à ne pas avoir empêché un fait délictueux ou à être resté sur place lorsqu’il a été perpétré ! Le délit associatif –de malfaiteurs, subversif, terroriste etc.– constitue également une arme de choix en ce qu’il permet de sanctionner des relations et des affinités (réelles ou supposées) en les mettant sous un même chapeau, qu’il s’agisse de groupes ou d’organisations existants ou créées de toute pièce. A travers lui, l’État cherche souvent aussi à construire une lecture du monde à son image en plaquant des structures hiérarchiques sur celles et ceux qui veulent en finir avec son existence, dont ils fait des petits soldats aux rôles bien définis et prêts à tout pour s’imposer. L’intentionnalité, complétant avantageusement son arsenal juridique, lui offre en outre la possibilité –qu’il ne se prive pas d’utiliser– d’intervenir y compris à titre préventif contre des idées telles qu’il les interprète et selon la dangerosité pratique qu’il leur attribue. En ces temps de guerre accrue « contre le terrorisme », le délit d’apologie est très en vogue, notamment en France : des positions orales ou écrites suffisent en tant que telles à rentrer dans le cadre de la loi antiterroriste. Outre son application à certains faits précis qui servent toujours de prétexte, cette accusation peut plus généralement s’avérer bien pratique pour condamner celles et ceux qui de diverses manières contestent le système en place.
Au-delà de ces quelques exemples, l’essence de toute loi est de codifier actes et comportements, pour fixer normes et interdictions en fonction des intérêts et de la morale dominants, ainsi que des rapports sociaux. Les prisons sont remplies à ras-bord de celles et ceux qui tombent au quotidien sous le coup de l’interminable liste des crimes et délits, c’est-à-dire des constructions juridiques élaborées par le pouvoir en place et régulièrement remises à jour pour le plus grand profit de l’État et du Capital.
Face au fonctionnement intrinsèque de la justice, on peut donc se demander si avoir recours si souvent au prisme du montage pour déchiffrer et dénoncer telle ou telle opération répressive particulière ne conduit pas, en creux, à réclamer une meilleure application de la loi démocratique. Poussée jusqu’à ses ultimes conséquences, cette grille de lecture qui part plus des normes de l’ennemi et de leur respect que de nos propres idées et perspectives, pourrait même servir à justifier de fait la terreur légale ordinaire dans toute sa tragique banalité.
Affirmer qu’innocence et culpabilité ne font pas partie de notre vocabulaire, c’est affirmer au contraire notre refus de réfléchir et d’agir en fonction de tout code pénal (et moral), notre détermination à rester en dehors des sables mouvants du droit – vers un a-légalisme qui n’a rien à voir avec un quelconque goût du martyre, mais tout avec la cohérence de nos idées anti-autoritaires.
Lorsque l’estocade est portée contre des individus ou des groupes en leur attribuant en vrac une série d’actions en utilisant le fait qu’ils défendent et diffusent des idées et des pratiques offensives contre l’autorité, une des questions qui se pose à celles et ceux qui partagent ce contre quoi ils se battent reste celle de la solidarité, et donc de la propagation de ces idées, de ces pratiques et de leurs pourquoi, sans laisser la répression monopoliser le terrain et le calendrier. Pour ne pas se limiter à un effet de « campagne » qui se cantonnerait à des situations et des moments isolés, cette solidarité pourrait également s’inscrire dans la continuité du combat contre les institutions qui appliquent si bien cette terreur quotidienne à travers les guerres, l’enfermement, la misère, l’exploitation, l’empoisonnement durable de la planète…
Parce qu’effectivement, les mots et les idées ont des conséquences, la proposition anarchiste que chacun-e reprenne sa vie en main, celle de la libre association et de l’auto-organisation dans le conflit, est aussi une méthode pour mener toujours plus loin la lutte contre l’existant, jusqu’à la destruction de toutes les cages.
Des anarchistes par delà des Pyrénées,
3 février 2015
en espagnol

 (Norbert Kröcher était rédacteur avec Ronald Fritzsch et P.P. Zahl de la revue FIZZ, de la gauche radicale berlinoise, de tendance anarchiste. Tous trois ont ensuite conflué dans le « Mouvement du 2 Juin ».)
(Norbert Kröcher était rédacteur avec Ronald Fritzsch et P.P. Zahl de la revue FIZZ, de la gauche radicale berlinoise, de tendance anarchiste. Tous trois ont ensuite conflué dans le « Mouvement du 2 Juin ».)